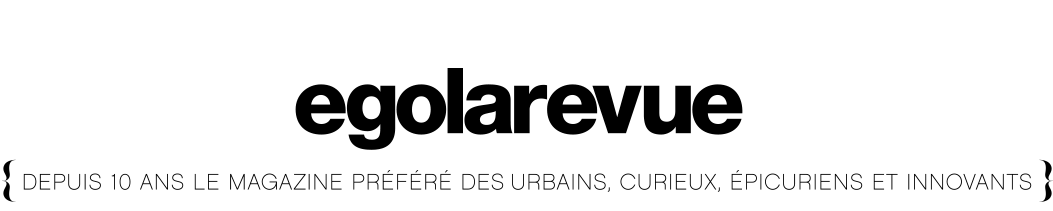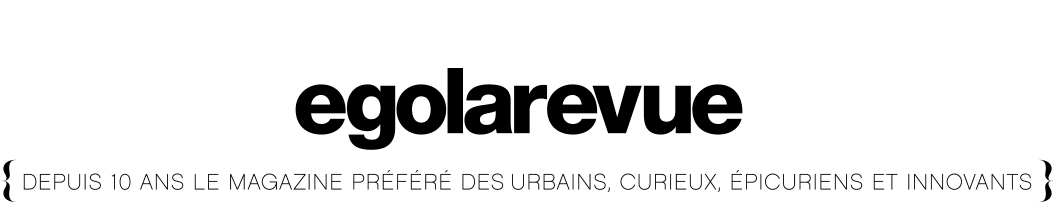La question qui fait débat : le ski est-il mort ?
- janvier 05, 2025
- by
- NF2
La question qui fait débat.
Le ski est-il mort ?
.
À l’évidence, certaines stations de ski de basse montagne sont condamnées. Mais une grande partie de celles situées au-delà de 1 600 mètres d’altitude conserve des atouts pour pérenniser leur activité touristique, tant l’hiver que l’été. Si beaucoup de données circulent sur les perspectives d’enneigement et les impacts écologiques de la pratique, des esprits s’élèvent aussi pour souligner les contradictions qu’elles laissent apparaître. Les montagnards, eux, résistent… et en 2030, ils seront olympiens !
.

.
Ahhhhh les années 60 et 70 ! Pour les amoureux de montagne et de ski, elles résonnent avec la légèreté et la volupté des flocons qui tombaient alors en abondance. Dans ces décennies-là, les Arcs sortaient de terre sur les alpages surplombant Bourg-Saint-Maurice à l’initiative de quelques pionniers emmenés par Robert Blanc. A une encablure, au-dessus du bourg d’Aime, le champion de ski Emile Allais officiait en tant que conseiller technique pour transformer les terres du lieu-dit « La Plagne ». En 1964, lors de l’Exposition nationale de Lausanne, une poignée de visionnaires présentait la maquette du premier domaine transfrontalier, celui des Portes du Soleil. Et même si beaucoup plus anciennes, les stations de Tignes et Val d’Isère peaufinaient les liaisons de ce qui est aujourd’hui l’un des terrains de glisse les plus réputés de la planète. Bref, partout, en Savoie et Haute-Savoie, dans les Alpes du Sud jusqu’aux Pyrénées, les chantiers allaient bon train. En ligne de mire : cet or blanc prometteur et hautement bankable.
.
Un demi-siècle plus tard, l’industrie du ski pense surtout à se réinventer. En cause ? Sa dépendance à la variabilité de l’enneigement, elle-même soumise aux effets du réchauffement climatique. Car bien que particulièrement difficiles à estimer pour les climatologues et parfois divergentes selon les modèles utilisés, les prévisions sur l’évolution de la neige n’apportent pas que des bonnes nouvelles. Dans le futur, la présence de neige variera énormément d’une altitude à l’autre et sa quantité restera conditionnée par plusieurs paramètres, dont les différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Prise comme étalon, la petite station du col de Porte, située à 1 325 mètres dans le massif de la Chartreuse, donne quelques tendances. Au cours de la période 1986-2005, l’épaisseur de neige moyenne hivernale s’y est établie à 80 centimètres, à comparer à des épaisseurs moyennes de 52 à 60 cm à l’horizon 2041-2060 et de 25 à 48 cm d’ici 2100. Globalement, il y aura donc moitié moins de neige sur nos massifs français à la fin du siècle. Les périodes d’enneigement seront plus courtes, avec un retard en début de saison et une fonte plus précoce au printemps. De bonnes couches d’or blanc ne seront pas impossibles. Mais elles seront rares !
Dès lors, le ski est-il mort ?
Par endroits, oui, et sûrement condamné à devenir une pratique encore plus élitiste, alors même que seulement 8 % des Français le pratiquent.
.
Pour nombre de stations, la survie est en hauteur. Valloire, par exemple, vient d’investir 17 millions d’euros dans sa nouvelle télécabine de la Sétaz, garantissant un accès à 1 900 mètres d’altitude, en 4 minutes seulement. Idem aux Arcs, où l’historique Transarc reliant les différents domaines skiables garantit désormais une vitesse de montée en 13 minutes, contre 20 auparavant. La station renoncera toutefois, vraisemblablement en 2027, à damer et sécuriser sa piste de l’Aiguille rouge du glacier du Varet, au profit d’une piste nature. Quant à la Plagne voisine, autre géante savoyarde, elle s’est lancée dans un vaste plan de survie pour mieux exploiter son potentiel. L’hiver dernier, elle a démonté les remontées mécaniques situées sur le glacier historique de la Chiaupe, rendant ainsi à la nature près de 9 hectares. Deux cents mètres plus bas, sur un autre versant considéré comme « plus sain », une nouvelle télécabine a vu le jour, conçue pour transporter aussi bien les skieurs l’hiver que les vététistes ou les randonneurs l’été. A l’image d’un grand nombre de stations, la Plagne tente de déployer un modèle touristique fonctionnant autour des quatre saisons. Enjeu : sortir du « tout-ski », tout en se préservant d’un « sans-ski » que la plupart des maires de montagne considèrent comme invivable, aussi bien socialement qu’économiquement.
De fait, cette montagne qui a apporté des ressources importantes à des zones d’agropastoralisme en plein exode rural dans les années 60 et 70, reste sous perfusions massives de l’Etat, confortée par son poids de 11 milliards d’euros dans l’économie française, les 100 000 emplois directs et indirects impulsés par la saison de ski alpin et les 7 millions de touristes étrangers la fréquentant chaque hiver. En tant que président de l’Association nationale des maires des stations de montagne, Jean-Luc Boch n’en finit pas de prendre son bâton de pèlerin pour interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d’accompagner l’adaptation des territoires montagneux. « Notre modèle fonctionnera encore dans 50 ans, martèle-t-il. Mais il faut en effet évoluer et nous n’avons pas attendu que les ONG nous tapent dessus pour le faire ! Cela fait quinze, vingt ou trente ans que nous modifions nos comportements et que l’on offre des alternatives dans nos pratiques, pour certaines très innovantes. Alors oui, cette transition existe, elle nous oblige à évoluer vite, mais arrêtons le ski bashing ! ».
.

.
Michel Barnier, pour sa part, (ancien nouveau) Premier ministre aux commandes, a envoyé un signal fort aux premières heures de sa prise de fonction en apportant la garantie financière qui manquait au Comité international olympique (CIO) pour confirmer l’organisation des Jeux olympiques de 2030 dans les Alpes françaises. Les opposants sont évidemment vent debout, dénonçant la perspective de JO à la neige… sans neige, avec tout ce que cela comportera de dérives écologiques. Mais selon le cabinet d’études parisien Asterès, l’événement pourrait générer 48 000 emplois, 3,6 milliards d’euros de valeur ajoutée et 1,6 milliard d’euros de recettes fiscales et sociales. Il serait aussi un accélérateur de développement sur les sujets de mobilité à destination des stations, d’innovations technologiques et de transformation du modèle de la montagne. Bref, le ski est mort, vive le ski !
« Notre modèle fonctionnera encore dans 50 ans. Nous n’avons pas attendu que les ONG nous tapent dessus pour modifier nos comportements et offrir des alternatives dans nos pratiques, pour certaines très innovantes. Alors oui, la transition existe, elle nous oblige à évoluer vite, mais arrêtons le ski bashing ! ».
Jean-Luc Boch, président de l’Association nationale des maires des stations de montagne et maire de La Plagne
Photos © Tony Harrington ; © Agence ATEAM Architectes & Basilico Design ; © Boris Molinier
AUTEUR Nancy Furer
.
.